06/01/2018
Dans la dèche au Royaume enchanté
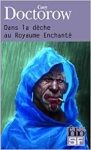 Dans un monde futuriste, la société Bitchum a créé une technique rendant les humains virutellement immortels grâce à un système de sauvegarde régulière du cerveau (comme pour un disque dur) greffé ensuite sur la personne défunte. Alors que tout le monde est connecté par son esprit à un réseau central (sorte de matrice), le système monétaire n'existe plus, remplacé par un système de réputation et de popularité... L'histoire débute avec Julius qui travaille à Disney World et qui se fait assassiner. Ses soupçons se portent immédiatement sur Debra, une concurrente.
Dans un monde futuriste, la société Bitchum a créé une technique rendant les humains virutellement immortels grâce à un système de sauvegarde régulière du cerveau (comme pour un disque dur) greffé ensuite sur la personne défunte. Alors que tout le monde est connecté par son esprit à un réseau central (sorte de matrice), le système monétaire n'existe plus, remplacé par un système de réputation et de popularité... L'histoire débute avec Julius qui travaille à Disney World et qui se fait assassiner. Ses soupçons se portent immédiatement sur Debra, une concurrente.
Considéré par le magazine Forbes comme une des personnalités les plus influentes du web, le blogueur Cory Doctorow (qui milite également pour des lois moins contraignantes concernant les droits d'auteur sur internet (1)) propose pour son premier roman un croisement entre polar, reflexion sur les réseaux sociaux et leur impact sur la société (2), et cyberpunk, où l'immersion de l'humanité dans un gigantesque système électronique (3) n'est pas sans rappeler des oeuvres comme Le passeur (1993) de Lois Lowry, Neuromancien (1980) de William Gibson, Ubik (1969) de Philip K. Dick ou encore Simulacron 3 (1964) de Daniel F. Galouye. Plus un tour de force qu'un chef-d'oeuvre, ce roman croise donc et subtilement plusieurs tendances de la science-fiction moderne couplées au roman noir, et a valu à son auteur le prix Locus du meilleur premier roman. Stimulante, l'oeuvre - assez courte - se lit d'une traite. J. N
Cory Doctorow, Dans la dèche au Royaume Enchanté, Folio SF, 2008, 230 p.
Paru pour la première fois en 2003 sous le titre original Down and Out in the Magic Kingdom.
- Prix Locus du meilleur premier roman - 2003
- Nomination au Prix Nebula - 2004
(1) Son roman est téléchargeable gratuitement.
(2) On peut considérer que le thème est avant-gardiste vu la date de parution du roman (2003).
(3) ou ce qu'un internaute a appelé dans son commentaire sur Amazon "une "pannexion" de l'humanité dans un internet ubiquitaire".
20:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cory doctorow, science-fiction, cyberpunk, dans la dèche au royaume enchanté
02/01/2018
Rêve de fer
 Avant Eric-Emmanuel Schmitt et sa fameuse biographie de 2001 (1), Norman Spinrad avait déjà opéré sur le personnage d'Hitler une uchronie en 1972. Né en Autriche en 1889 puis émigré en Allemagne, il servit dans l'armée allemande durant la Première guerre mondiale. "La paix venue, il fit une brève incursion dans les milieux radicaux munichois avant d'émigrer à New York en 1919 (2). Son parcours new-yorkais le mènera à épouser le métier d'écrivain. "La Convention mondiale de Science-fiction lui décerna en 1955 un Hugo posthume pour Le Seigneur du Svastika, terminé juste avant sa mort en 1953" (3). C'est sur cette notice biographique que débute ce roman culte de Spinrad (4) qui se poursuit par une mise en abîme (l'oeuvre d'Hitler dans l'oeuvre...) puis en postface par une étude brillante sur la structure et la symbolique du roman écrit par un auteur fictif. Allégorie géniale et extrême du IIIème Riech hitlérien, Rêve de fer est une parodie subtile du nazisme ainsi qu'un exercice de style original et réussi. Extrait :
Avant Eric-Emmanuel Schmitt et sa fameuse biographie de 2001 (1), Norman Spinrad avait déjà opéré sur le personnage d'Hitler une uchronie en 1972. Né en Autriche en 1889 puis émigré en Allemagne, il servit dans l'armée allemande durant la Première guerre mondiale. "La paix venue, il fit une brève incursion dans les milieux radicaux munichois avant d'émigrer à New York en 1919 (2). Son parcours new-yorkais le mènera à épouser le métier d'écrivain. "La Convention mondiale de Science-fiction lui décerna en 1955 un Hugo posthume pour Le Seigneur du Svastika, terminé juste avant sa mort en 1953" (3). C'est sur cette notice biographique que débute ce roman culte de Spinrad (4) qui se poursuit par une mise en abîme (l'oeuvre d'Hitler dans l'oeuvre...) puis en postface par une étude brillante sur la structure et la symbolique du roman écrit par un auteur fictif. Allégorie géniale et extrême du IIIème Riech hitlérien, Rêve de fer est une parodie subtile du nazisme ainsi qu'un exercice de style original et réussi. Extrait :
"Le traité de Karmak doit être dénoncé et tous les mutants et métis extirpés à jamais du dernier pouce de territoire helder. (...) Les lois sur la pureté raciale doivent être sévèrement renforcées et, tenant compte du relâchement qui a permis dans le passé à toutes sortes d'agents contaminants de s'infiltrer dans le creuset génétique de Heldon, des camps de sélection devront être installés dans tout le pays, où seront tous les Helders dont la pureté génétique souffre la moindre contestation, jusqu'à ce que leur généalogie et leur structure génétique aient été rigoureusement examinées. Ceux dont sera prouvée la contamination génétique auront le choix entre l'exil et la stérilisation." (5)
Norman Spinrad, Rêve d'acier, FOLIO SF, 2014, 383 p.
Paru pour la première fois en 1972 sous le titre original The Iron Dream.
- Prix Apollo - 1974
(1) Il s'agit de deux récits en parallèle, une biographie romancée d'Adolf Hitler et une biographie uchronique d'Adolf H.
(2) p. 19.
(3) p. 20.
(4) Auteur américain de science-fiction, Spinrad (né en 1940) fait partie de la nouvelle vague littéraire de science-fiction (1965-1980), née en Angleterre et répandue ensuite aux Etats-Unis. Ayant pour objet principal de renouveler les thèmes traités ainsi que les structures narratives. Font partie de cette vague Philip K. Dick, Thomas M. Dish, Philip José Farmer, Christopher Priest, Ursula K. Le Guin, Stanislaw Lem, Robert Silverberg...
(5) p. 183-184.
14:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norman spinrad, hiter, rêve d'acier, uchronie
31/12/2017
Brèche dans l'espace / En attendant l'année dernière
 Preuve en est du parcours littéraire chaotique de notre auteur de S.F préféré, ces deux romans que nous avons lus à la suite lors de vacances passées dans les Cyclades n'ont rien à voir l'un avec l'autre alors qu'ils furent rédigés la même année. C'est rappeler ici que Philip K. Dick a eu des périodes très différentes d'écriture, la seconde étant inaugurée au début des années 1960 avec le cultissime Le maître du Haut-chateau, lauréat du prestigieux Prix Hugo (1). Pourtant Brèche dans l'espace ressemble plus, au niveau de sa structure linéaire et de son intrigue peu complexe à des livres comme Les marteaux de Vulcain ou Les chaînes de l'avenir. Alors qu'il est urgent de trouver une solution au problème de la surpopulation de la terre, des scientifiques découvrent par hasard un portail ouvrant sur un nouvel eldorado. Pour le meilleur ou pour le pire ? Agréable à lire, l'histoire se lit d'une traite et on ne s'y perd jamais.
Preuve en est du parcours littéraire chaotique de notre auteur de S.F préféré, ces deux romans que nous avons lus à la suite lors de vacances passées dans les Cyclades n'ont rien à voir l'un avec l'autre alors qu'ils furent rédigés la même année. C'est rappeler ici que Philip K. Dick a eu des périodes très différentes d'écriture, la seconde étant inaugurée au début des années 1960 avec le cultissime Le maître du Haut-chateau, lauréat du prestigieux Prix Hugo (1). Pourtant Brèche dans l'espace ressemble plus, au niveau de sa structure linéaire et de son intrigue peu complexe à des livres comme Les marteaux de Vulcain ou Les chaînes de l'avenir. Alors qu'il est urgent de trouver une solution au problème de la surpopulation de la terre, des scientifiques découvrent par hasard un portail ouvrant sur un nouvel eldorado. Pour le meilleur ou pour le pire ? Agréable à lire, l'histoire se lit d'une traite et on ne s'y perd jamais.
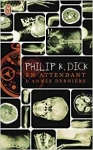 C'est la différence essentielle avec En attendant l'année dernière (un titre très "dickien") où dans un monde futuriste, Gino Molinari, secrétaire des Nations unies et "despote obligé" fait de son mieux pour préserver l'humanité d'une destruction imminente. Pour cela, il fait alliance avec les Lilistariens pour se prémunir contre les attaques des Reegs, une race insectoïde... Le personnage principal, Eric Sweetscent, chirurgien spécialisé dans les greffes d'organes et médecin personnel de Molinari a la lourde tâche de sauver l'humanité (rien que ça) tout en tentant de se défaire de l'emprise de Kathy, son épouse envahissante. Tous deux sont amenés à consommer du JJ-180, une drogue à double tranchant. Rendant accro et attaquant le cerveau, celle-ci permet en même temps de se déplacer dans le temps, à moins qu'il s'agisse de voir l'avenir ou encore d'être transposé dans des univers parallèles, ou tout à la fois... C'est là que le lecteur se perd. Délires spatio-temporels, drogues altérant la réalité, réflexion philosophique sur l'humanité mais également sur la place de la technologie, récit traitant de l'avenir de l'humanité sur fond de guerre interstellaire mais centré sur quelques personnages au bord de la rupture, délires mystiques (2)... Du pur Philip K. Dick qu'on adore et qui préfigure des œuvres cultes comme Ubik (1969) et Substance mort (1977). J. N
C'est la différence essentielle avec En attendant l'année dernière (un titre très "dickien") où dans un monde futuriste, Gino Molinari, secrétaire des Nations unies et "despote obligé" fait de son mieux pour préserver l'humanité d'une destruction imminente. Pour cela, il fait alliance avec les Lilistariens pour se prémunir contre les attaques des Reegs, une race insectoïde... Le personnage principal, Eric Sweetscent, chirurgien spécialisé dans les greffes d'organes et médecin personnel de Molinari a la lourde tâche de sauver l'humanité (rien que ça) tout en tentant de se défaire de l'emprise de Kathy, son épouse envahissante. Tous deux sont amenés à consommer du JJ-180, une drogue à double tranchant. Rendant accro et attaquant le cerveau, celle-ci permet en même temps de se déplacer dans le temps, à moins qu'il s'agisse de voir l'avenir ou encore d'être transposé dans des univers parallèles, ou tout à la fois... C'est là que le lecteur se perd. Délires spatio-temporels, drogues altérant la réalité, réflexion philosophique sur l'humanité mais également sur la place de la technologie, récit traitant de l'avenir de l'humanité sur fond de guerre interstellaire mais centré sur quelques personnages au bord de la rupture, délires mystiques (2)... Du pur Philip K. Dick qu'on adore et qui préfigure des œuvres cultes comme Ubik (1969) et Substance mort (1977). J. N
Brèche dans l'espace, J'ai Lu, 2014, 251 p. (Paru pour la première fous en 1966 sous le titre original Crack in the space).
En attendant l'année dernière, J'ai Lu, 2015, 287 p. (Paru pour la première fois en 1966 sous le titre original Now wait for last year).
(1) Ce roman phare est actuellement décliné en série TV par le site Amazon. La saison 3 devrait débuter en 2018.
(2) Le secrétaire des nations unies épouse les maladies des humains jusqu'à en mourir puis ressusciter à chaque fois, soit une dimension très religieuse qui rappelle la période mystique de l'auteur.
15:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : en attendant l'année dernière, philip k. dick, science-fiction, brèche dans l'espace
28/12/2017
Orgasme
 Le maître du roman subversif américain poursuit sa satire radicale de notre société. Soit Penny, jeune femme on ne peut plus normale et future avocate, qui rencontre Linus Maxwell, l'homme le plus riche de la planète. Ne comprenant pas vraiment pourquoi l'homme lui voue un tel intérêt, Penny se laisse quand même emporter dans son rêve, jusqu'à réaliser que Maxwell est obsédé par le plaisir féminin... Dans la même lignée de Snuff qui montrait l'envers de l'industrie pornographique, Orgasme s'attaque à la quête du plaisir féminin, et au passage à l'industrie des sex-toys qui n'en finit pas d'innover. Si le traitement du plaisir féminin prête à des interprétations diverses, il faut aller au-delà de cela et constater que le thème central est en fait l'addiction de nos sociétés à l'excitation, phrase qui apparaît une fois vers le milieu de l'ouvrage. Dans Fight Club (1995), il s'agissait de la société de consommation, ici il s'agit d'une société recherchant systématiquement les sensations fortes. Les deux sont d'ailleurs complémentaires. Hormis le style minimaliste comme à l'accoutumée, le récit est trash et très démonstratif. Probablement l'un des romans les plus aboutis de Palahniuk. J. N
Le maître du roman subversif américain poursuit sa satire radicale de notre société. Soit Penny, jeune femme on ne peut plus normale et future avocate, qui rencontre Linus Maxwell, l'homme le plus riche de la planète. Ne comprenant pas vraiment pourquoi l'homme lui voue un tel intérêt, Penny se laisse quand même emporter dans son rêve, jusqu'à réaliser que Maxwell est obsédé par le plaisir féminin... Dans la même lignée de Snuff qui montrait l'envers de l'industrie pornographique, Orgasme s'attaque à la quête du plaisir féminin, et au passage à l'industrie des sex-toys qui n'en finit pas d'innover. Si le traitement du plaisir féminin prête à des interprétations diverses, il faut aller au-delà de cela et constater que le thème central est en fait l'addiction de nos sociétés à l'excitation, phrase qui apparaît une fois vers le milieu de l'ouvrage. Dans Fight Club (1995), il s'agissait de la société de consommation, ici il s'agit d'une société recherchant systématiquement les sensations fortes. Les deux sont d'ailleurs complémentaires. Hormis le style minimaliste comme à l'accoutumée, le récit est trash et très démonstratif. Probablement l'un des romans les plus aboutis de Palahniuk. J. N
Chuck Palahniuk, Orgasme, Paris, Sonatine Editions, 2016, 261 p.
Publié pour la première fois en 2014 sous le titre original Beautiful You.
13:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chuck palahniuk, orgasme
09/08/2017
Comprendre le génocide des arméniens
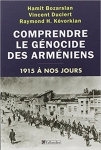 A l'heure où le génocide des arméniens ne peut plus être nié mais n'est toujours pas reconnu par la Turquie (où prévaut un révisionnisme d'Etat criseux) mais également l'ensemble de communauté internationale (1), cet ouvrage jette une lueur crue, un siècle plus tard, sur le premier génocide du XXème siècle.
A l'heure où le génocide des arméniens ne peut plus être nié mais n'est toujours pas reconnu par la Turquie (où prévaut un révisionnisme d'Etat criseux) mais également l'ensemble de communauté internationale (1), cet ouvrage jette une lueur crue, un siècle plus tard, sur le premier génocide du XXème siècle.
Première synthèse de grande envergure sur ce massacre qui fit 1.2-1.5 millions de morts, l'ouvrage est divisé en 3 parties thématiques. La première (Raymond H. Kévorkian) retrace le processus complexe des massacres et les contextualise, rappelant qu'ils ne surviennent pas ex-nihilo mais s'inscrivent dans le sillage de la politique du sultan ottoman Abbülhamid II. La communauté arménienne de l'Empire ottoman subissait déjà des repressions de grande ampleur en 1894-1895 puis en 1909. L'arrivée des Jeunes-Turcs au pouvoir (1908) ne change pas la donne. Les révolutionnaires du Comité Union et Progrès (CUP) veulent sauver un empire aux abois et décident de le nettoyer de ses communautés chrétiennes - notamment arménienne - considérées comme "ennemis de l'intérieur" et prises pour boucs émissaires dans la perte de territoires que doit céder l'Empire ottoman aux puissances européennes.
La deuxième partie (Hamit Bozarslan), démontrant au passage la continuité entre l'absolutisme hamidien et la politique des Jeunes-Turcs, analyse les fondements idéologiques du génocide des arméniens. Cette politique d'extermination est marquée par le darwinisme social qui est également au coeur de la politique nazie d'extermination des juifs d'Europe (le parallèle effectué entre les génocides des arméniens et des juifs est édifiant). Enfin, la troisième partie (Vincent Duclert) montre comment les puissances européennes portent une certaine responsabilité dans ce génocide, en le laissant se dissoudre dans les traités de paix des années 1920, et s'interroge aussi sur la responsabilité des chercheurs et des hommes politiques dans la question de la reconnaissance de ce génocide (qui ne se pose réellement qu'à partir de 1965) mais également sur les défis que pose ce génocide aux sciences sociales.
Parmi la longue littérature du génocide des arméniens, cet ouvrage pourvu d'une documentation impressionnante (notamment les archives ottomanes et allemandes de l'époque), précis et intelligent, ne laisse pas la moindre zone d'ombre sur la nature génocidaire du massacre des arméniens de 1915. Poursuivre le déni de ce génocide - qui n'a toujours pas donné lieu à une compensation financière pour les arméniens - équivaut tout simplement à de la myopie intellectuelle. J. N
Hamit Bozarslan, Vincent Duclert, Raymond H. Kévorkian, Comprendre le génocide des arméniens. 1915 à nos jours, Paris, Tallandier, 2015, 494 p.
(1) Hormis les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Israël, très nombreux sont les Etats qui ne reconnaissent pas officiellement (au niveau donc de l'instance étatique la plus élevée) ce génocide, parmi eux l'ensemble des pays d'Afrique, d'Asie (mis à part le Liban, la Syrie et la Russie) et d'Océanie. Les Etats reconnaissant officiellement le Génocide des Arméniens ne sont que 29 (dont le Vatican). Le premier à s'être engagé dans action est l'Uruguay (le 20 avril 1965).
14:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : génocide des arméniens, turquie, hamit bozarslan, révisionnisme, raymond h. kévorkian, vincent duclert, arménie, arméniens


